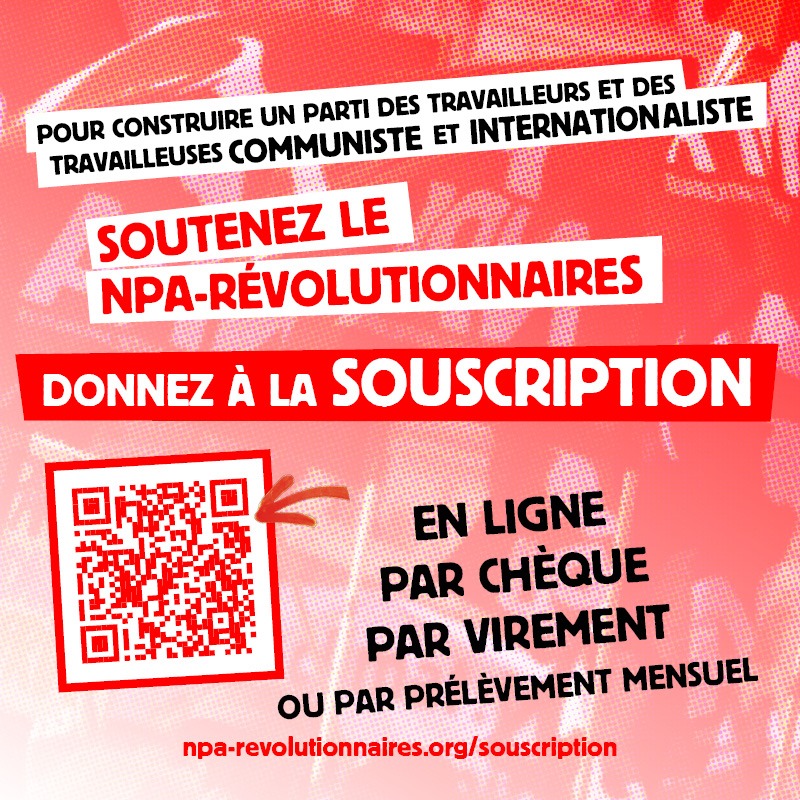Le 21 mars dernier, Macron limogeait brutalement le PDG d’EDF, Luc Rémont. La veille, sur le plateau de BFM Business, le patron de Saint-Gobain avait qualifié de « bras d’honneur à l’industrie française » l’idée d’enchères sur de futurs contrats de fourniture d’électricité. L’épisode éclaire crûment les relations, d’ordinaire discrètes, entre EDF, ses gros clients industriels et son actionnaire aujourd’hui unique, l’État français.
Tout le monde a encore en tête la flambée des prix de l’énergie de l’hiver 2022-2023, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de problèmes ayant mis à l’arrêt une partie du parc nucléaire français. Les prix de gros étaient multipliés par presque dix, asphyxiant des particuliers et des petites et moyennes entreprises, même si le tarif réglementé de vente d’électricité, fixé par l’État, a un peu limité la casse pour une partie importante des consommateurs.
Il faut dire qu’il est bien difficile de s’y retrouver dans ce mécanisme de fixation des prix, pourtant aujourd’hui d’une brûlante actualité.
Une ouverture à la concurrence négociée…
2025 verra en effet la fin de la régulation actuelle du marché français de l’électricité, négociée à titre transitoire il y a une quinzaine d’années entre l’État français et l’Union européenne. Car si EDF, depuis longtemps exportateur d’électricité, profitait de l’ouverture du marché européen au tournant des années 2000, l’État rechignait alors à ouvrir, en contrepartie, le marché français à la concurrence – avec, notamment, le maintien de tarifs réglementés pour les particuliers (tarif « bleu ») et les industriels (tarifs « jaune » et « vert »). Le bras de fer avec l’Europe a conduit à l’adoption, en 2010, de la loi Nome (Nouvelle organisation du marché de l’électricité), instaurant un Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). Le dispositif impose à EDF de vendre jusqu’environ un quart de sa production à des fournisseurs dits alternatifs, à un prix faible car basé sur les coûts du nucléaire. Cette électricité peut alors être revendue plus cher, soit à des particuliers en dessous du tarif « bleu » dont ils peuvent encore bénéficier, soit à des industriels sous les prix des marchés de gros. Or sur ces marchés, seule autre voie d’approvisionnement depuis la fin des tarifs « jaune » et « vert » en 2016, les prix sont aujourd’hui élevés ; ils dépendent en partie de ceux du gaz, la production électrique des centrales à gaz étant indispensable en période de pic de consommation.
… au bénéfice des industriels
L’État a ainsi fait le choix d’un dispositif coûteux pour EDF, au profit de capitalistes dont il sert les intérêts. C’est le cas de concurrents dont la plupart – TotalEnergies et Engie (anciennement GDF-Suez) mis à part – ne font qu’acheter et revendre, voire simplement spéculer, sans avoir jamais investi dans la production. C’est aussi celui de leurs clients, parmi lesquels les très gros consommateurs d’électricité que sont les industries dites « électro-intensives » – chimie, sidérurgie, transports, etc.
Nouvelle régulation et jeu de dupes
Mais dans la perspective de la fin de l’ARENH en décembre prochain, les négociations entre industriels « électro-intensifs » et EDF sur des contrats d’approvisionnement à long terme, basés sur le nucléaire pour amortir les fluctuations des marchés sur dix ou quinze ans, ont été tendues. Invoquant de lourds investissements à venir pour le maintien et le renouvellement de son parc nucléaire, et pour la transition écologique, EDF visait des tarifs à la hausse, dans le cadre d’une nouvelle régulation convenue avec l’État fin 2023 et incluant une redistribution de ses profits, taxés au-delà de certains seuils.
Les propositions n’ont pas convaincu : début mars, seuls un ou deux de ces nouveaux Contrats d’allocation de production nucléaire (CAPN) étaient signés, plus quelques lettres d’intention. Espérant peut-être accélérer leur signature, EDF a alors annoncé leur mise aux enchères à l’échelle européenne. Dès le lendemain, un communiqué de l’Uniden, discret lobby des « électro-intensifs » plutôt habitué aux cabinets ministériels, dénonçait EDF qui « préférerait clairement vendre aux plus offrants plutôt qu’à ceux qui en ont besoin », à savoir ses adhérents, « gages pour une bonne part de la souveraineté industrielle de la France » (on trouve parmi eux Saint-Gobain, dont le PDG a été plus direct).
Un élan aussi touchant de patriotisme économique ne pouvait laisser indifférent Macron, qui n’a mis que deux semaines à remplacer le PDG d’EDF par celui de Framatome, présenté comme un profil « plus industriel ». Tout un symbole, mais qui ne s’adresse pas aux agents d’EDF, spectateurs comme tous les travailleurs de ce jeu de dupes entre l’État et le grand patronat.
Depuis, les tractations commerciales sont retournées dans l’ombre, et on n’en sait pas grand-chose. Reste une certitude : si l’État demande à EDF de faire un effort envers ses gros clients industriels, il n’hésitera pas à faire payer l’électricité plus cher aux particuliers, pour financer l’entretien des infrastructures et la relance du programme nucléaire voulue par Macron. D’ailleurs, selon l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, la régulation post-ARENH devrait faire flamber la facture en 2026…
Marc Peram et Gérard Wegan