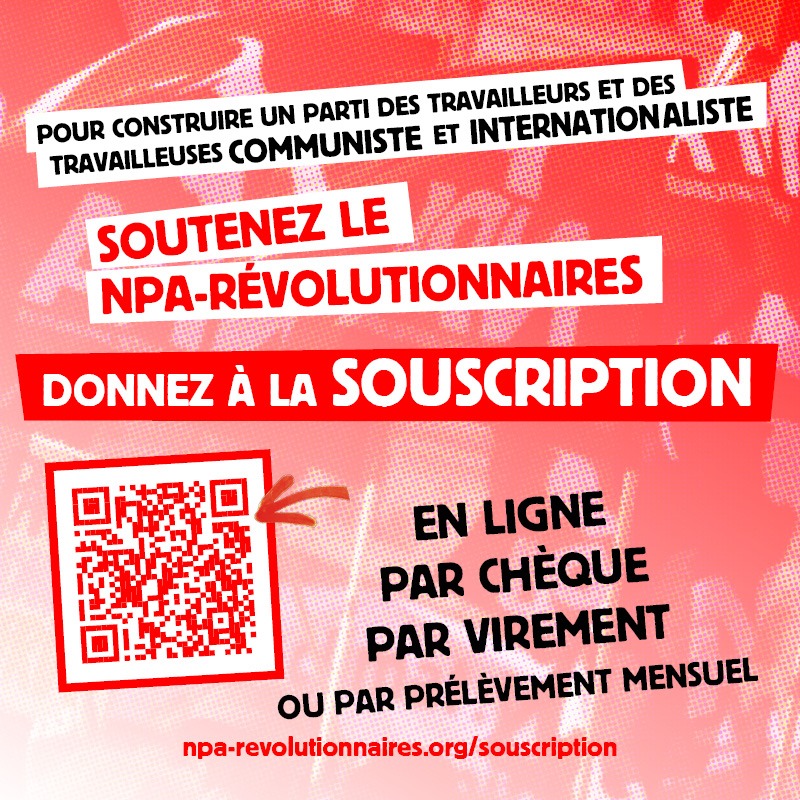Ci-dessous la retranscription de l’introduction à la réunion-débat tenue à Paris le 10 avril
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd’hui pour un débat autour de la situation actuelle en Turquie. À l’heure où l’on parle, les étudiants continuent de manifester dans leurs universités dans de nombreuses villes du pays, malgré une circulaire gouvernementale menaçant l’ensemble des personnels, professeurs et étudiants de licenciement et expulsions s’ils osent participer aux manifestations. Nous adressons notre totale solidarité à celles et ceux qui combattent aujourd’hui le régime d’Erdoğan et dont le combat résonne avec nos propres combats ici en France, alors qu’Erdoğan apporte lui aussi son soutien à son homologue d’extrême droite française, Marine Le Pen qui vient d’être condamnée. D’un côté comme de l’autre de la barricade, on est conscient que la lutte se joue à l’échelle internationale – ce n’est pas pour rien si les manifestants serbes ou grecs regardent du côté de la Turquie et inversement. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui se joue aujourd’hui en Turquie, ce qui a poussé Erdoğan à tenter son coup de force dictatorial, discuter des forces, limites et perspectives de la mobilisation en cours – dans la limite des informations dont nous disposons en France.
I) Description du régime
Erdoğan ne vient pas de n’importe où, il est un pur produit du développement capitaliste en Turquie. Le courant islamiste existe en Turquie depuis les années 1960 alors que les classes dirigeantes turques cherchent un moyen de contenir le développement des organisations ouvrières socialistes. La Turquie, qui profite alors des capitaux étrangers – principalement occidentaux – est en effet en train de s’industrialiser et une classe ouvrière combative prend le chemin des grèves. Le ralentissement de l’économie dans la seconde moitié des années 1970 a provoqué son lot de mobilisations ouvrières et de fermentation politique, au point où l’armée turque lance un coup d’État en 1980, après avoir reçu l’autorisation des États-Unis et de l’Otan. L’armée ne fait pas que réprimer violemment la classe ouvrière, elle arbitre aussi les conflits entre capitalistes et réorganise l’économie en ouvrant encore davantage la Turquie aux capitaux occidentaux, procède à de nombreuses privatisations et distribue les marchés publics aux entreprises privés – évidemment, l’armée elle-même met la main sur une partie de l’industrie.
Le vide créé par la répression des organisations ouvrières et socialistes, alors que de profonds mouvements de grèves se développent à la fin des années 1980, va permettre aux militants islamistes de postuler à la direction des masses pauvres des centres urbains, à l’aide de différents réseaux de charité, d’écoles coraniques, d’une prise en main de nombreuses municipalités et d’une critique de l’Occident. Ce courant politique cherche à développer le capitalisme turc sur une base culturelle et religieuse, pas nationaliste : la Turquie doit se tourner vers l’« oumma » musulmane (vers le régime de Kadhafi et l’Iran) pour contrebalancer l’impérialisme occidental. Les mosquées islamistes organisent le boycott des produits liés aux Occidentaux et au pouvoir kémaliste, et collectent des fonds auprès des fidèles. L’émergence de l’islam politique (notamment à travers le Parti du bien-être) menace l’hégémonie kémaliste et ses réseaux clientélistes constitués grâce à sa mainmise sur l’appareil d’État. En 1991, les islamistes du Parti du bien-être réalisent 19,1 % des voix, et accèdent pour la première fois au pouvoir au sein d’une coalition gouvernementale. Petit à petit, les cercles kémalistes cherchent à freiner l’établissement des islamistes au sein de l’appareil d’État. En 1997, l’armée demande au gouvernement d’interdire et de punir les partis islamistes les plus radicaux, de mettre fin aux communautés islamiques, de surveiller les capitaux islamiques, de renforcer l’interdiction des vêtements religieux dans la fonction publique, d’expulser les islamistes de l’appareil d’État, etc. C’est dans ce contexte de lutte de pouvoir entre deux fractions concurrentes (mais alliées face à la classe ouvrière) qu’Erdoğan, alors maire d’Istanbul, est arrêté en décembre 1997 pour avoir récité un poème islamique dont le texte dit : « Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques / Les mosquées sont nos casernes, les croyants nos soldats / Cette armée divine garde ma religion. » Vous l’avez compris, les kémalistes ne combattent pas les islamistes simplement pour défendre un État laïc et séculier – après tout, eux aussi ont su utiliser la religion contre le développement du mouvement socialiste –, il s’agit surtout de défendre leurs intérêts matériels. Le Parti du bien-être dissous, il est remplacé par le Parti de la justice et du développement, l’AKP, dirigé par Erdoğan, qui fait alors office d’islamiste « modéré » aux yeux de l’Occident. Modéré, c’est vite dit, quand on voit le poème qu’il lit, ou qu’il gracie certains auteurs du pogrom de Sivas, qui avait causé la mort de 37 alévis en 1993. Mais effectivement, Erdoğan fait alors office de réformateur : il s’inspire des chrétiens-démocrates allemands pour développer son parti, modernise Istanbul, candidate à l’Union européenne, fait même le tour des États-Unis pour affirmer la place de la Turquie dans l’ordre impérialiste. Les islamistes utilisent alors la nécessité de réformes démocratiques pour tenter de déboulonner les kémalistes de leurs postes dans l’appareil d’État, au nom de versets du Coran mettant en avant les vertus de la « compétition économique ».
Évidemment, ces islamistes « démocrates » ne vont pas le rester longtemps. Des désaccords politiques finissent par écarter Erdoğan et son allié de la veille Gülen. Problème, les deux souhaitent gouverner et placer leurs propres pions dans l’appareil d’État.
Outre ces querelles internes au clan islamiste, si Erdoğan réussit à rester au pouvoir grâce à la répression, sa base sociale rétrécit à mesure que la crise de 2008 percute la Turquie, qui se développe principalement grâce aux crédits étrangers : l’inflation chronique devient un phénomène courant, le chômage se développe, la classe ouvrière engage une série de grèves importantes, y compris parfois par-dessus-la tête des syndicats. La contestation contre la politique de l’AKP se développe petit à petit : elle a d’ailleurs explosé en 201. Lors du « Printemps turc » de la révolte de Gezi, la population d’Istanbul refuse la destruction d’un parc au profit d’un centre commercial et entraîne des centaines de milliers de jeunes et travailleurs dans une lutte contre le pouvoir.
En 2016, l’échec d’une tentative de coup d’État contre le gouvernement Erdoğan permet à celui-ci de faire le ménage au sein de l’appareil d’État. Les derniers kémalistes dans les rouages du pouvoir sont purgés, les partisans de Gülen également, et Erdoğan procède au changement des officiers dans l’armée. Mais le pouvoir ne s’arrête pas là et profite de l’état d’urgence pour s’attaquer à l’ensemble des formations politiques kurdes ou socialistes du pays.
Dans ces années-là, l’AKP enchaîne les défaites électorales et perd les principaux poumons économiques du pays au profit du Parti républicain du peuple (CHP), d’inspiration kémaliste. Ce fut le cas à Istanbul et Ankara. C’est dans ce contexte de recul qu’Erdoğan tente son coup de force en 2025 alors qu’il dispose de points d’appui sur la scène internationale.
Ce n’est pas pour rien que les dirigeants du CHP répètent qu’Erdoğan réalise son coup de force avec l’assentiment de Trump. L’arrivée à la Maison blanche de celui-ci répand un vent réactionnaire partout sur le globe, qui renforce les tendances autoritaires de l’extrême droite. Trump avoue lui-même avoir donné son assentiment à Erdoğan quand il dit tranquillement, face caméra à Netanyahou qu’il « connaît bien Erdoğan » et qu’il peut le contrôler alors que les gouvernements turc et israélien s’opposent sur la question de la Syrie ? Mais Trump n’est pas le seul allié d’Erdoğan : alors que Trump met la pression aux Européens, ceux-ci invitent la Turquie à la table des négociations dans le cadre de l’« Europe de la défense » : l’industrie de l’armement turque, sa place stratégique au niveau du delta du Bosphore, en font un acteur important. La rétention en Turquie des migrants syriens, et de façon générale de migrants venant du Moyen-Orient, est un service pour lequel l’Union européenne donne à Erdoğan une aide financière pour l’entretien des camps. Alors, pas question de critiquer trop fort Erdoğan quand il réprime les manifestants, Macron ne va pas plus loin qu’une déclaration, dans laquelle il appelle la Turquie à « poursuivre son chemin démocratique », mais lequel ? Il faut dire que Macron connaît bien le chemin démocratique que prennent les manifestants : le long de la trajectoire d’un LBD !
Dans le cadre de sa politique de « Grande Turquie », Erdoğan multiplie les initiatives pour peser sur la Méditerranée et le Proche-Orient : il appuie les Printemps arabes pour appuyer les Frères musulmans, il intervient directement en Libye et en Syrie, envoie des troupes en Azerbaïdjan, confronte la France et la Grèce dans leurs eaux territoriales et dans la gestion des hydrocarbures méditerranéens, condamne la politique génocidaire de l’État d’Israël – tout en continuant de l’alimenter en pétrole. Ce déploiement régional cherche à répondre à plusieurs objectifs : détourner la colère sociale intérieure en réalisant des victoires à l’international, à s’affirmer comme puissance régionale et dominant de nouveaux marchés (notamment de nouvelles routes de pipeline depuis l’Irak ou la Libye), recréer un semblant d’influence « ottomane » face aux impérialistes européens, isoler l’Iran.
La Turquie profite de la réorganisation de l’ordre impérialiste à l’échelle mondiale, mais ses victoires extérieures, si elles permettent au gouvernement turc de rayonner et calment momentanément la colère sociale à l’intérieur, participent aussi à son isolement – la Turquie est par exemple exclue de différents marchés par la France et la Grèce, les États-Unis mettent des limites à son offensive contre les Kurdes de Syrie, etc. Dans ce cadre, il est possible que différents secteurs de la bourgeoisie n’aient pas totalement les mêmes plans pour la réorganisation de la région avec les Occidentaux. Comment ?
En Turquie, la note est salée. Les politiques d’aménagement structurel, de modernisation – comme à Istanbul au début des années 2000 – sont absentes, comme le démontrent les conséquences du tremblement de terre de 2023 qui ont fait plus de 50 000 morts et alimentent une forte colère sociale contre le régime – le régime ayant laissé les promoteurs immobiliers construire n’importe comment sans contrôler les normes sismiques. L’État « protecteur » d’Erdoğan est aussi un échec pour la partie de la bourgeoisie qui ne bénéficie pas des monopoles octroyés par les contrats d’État. Quant aux classes populaires, elles subissent l’inflation (jusqu’à 40 % officiellement), la jeunesse est en manque d’ascension sociale (elle est diplômée mais n’a pas de boulot). Dans ces conditions, l’AKP craint de perdre les prochaines élections au profit du CHP qui cristallise l’ensemble de la contestation sociale : Erdoğan a donc pris les devants.
D’où les arrestations des principaux dirigeants du CHP, dont Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul, alors que celui-ci devait être confirmé comme candidat à l’élection présidentielle de 2028 à la suite d’une primaire ouverte où quinze millions de Turcs ont participé. On lui a même supprimé son diplôme universitaire, car, pour être élu en Turquie, il faut un diplôme universitaire, donc voilà le principal opposant évincé. Erdoğan veut bien des élections mais il veut choisir son adversaire et pas question que les partis d’opposition sortent du sentier tracé par le régime ! L’annulation du diplôme d’İmamoğlu, en plus d’être une mesure complètement anti-démocratique et autoritaire, constitue aussi un symbole. Le maire d’Istanbul a eu son diplôme dans une université turque de Chypre, avant les vagues de privatisations, c’était souvent la seule voie pour une partie de la petite bourgeoisie d’obtenir des diplômes : l’annulation récente de toutes ces promotions est un coup contre le CHP mais aussi un message envoyé à cette couche de la population qui aspirait à une élévation économique.
L’annonce de ce coup de force et l’annulation du diplôme ont mis les étudiants dans la rue, qui ont réussi par leur détermination à amener le CHP à s’engager dans les manifestations, ce qui n’était apparemment pas son but premier. Erdoğan s’attendait-il à une telle réaction ? Difficile de savoir, en tout cas elle continue encore aujourd’hui, presque un mois après le début des premières manifestations.
II) Qu’est-ce que le CHP ? Le poids du kémalisme
Qu’est-ce que le CHP, le Parti républicain du peuple ? Dans la presse française on nous le présente comme un parti « social-démocrate » de centre-gauche. Il n’en est rien, le CHP n’est en rien « social-démocrate », c’est un des principaux partis de la bourgeoisie turque. Là où il est au pouvoir, le CHP accompagne les politiques anti-sociales mises en place par l’AKP. Son respect pour l’ordre bourgeois l’amène à canaliser la mobilisation en cours vers des impasses institutionnelles. Alors que les manifestants s’affrontent à la police tous les soirs, le CHP cherche à espacer un maximum les manifestations et à les restreindre à Istanbul, alors que la colère secoue y compris les bastions de l’AKP dans le cœur du pays. Aujourd’hui, le CHP milite pour une élection présidentielle anticipée : comme s’il était possible de gagner des élections quand les opposants sont envoyés en prison… ou qu’on pouvait mettre fin au régime d’Erdoğan simplement en mettant un bulletin dans l’urne. Le CHP n’est pas stupide : s’il refuse d’entamer le combat dans la rue c’est parce que, comme l’AKP, il craint qu’une irruption des masses sur la scène politique entraîne un effondrement de l’État turc (et donc du capitalisme en Turquie). Plutôt se sacrifier que mettre en danger les intérêts de la bourgeoisie. Ce qui n’est pas étonnant pour un parti héritier du kémalisme.
Celui-ci s’identifie aux aspirations de la bourgeoisie turque à la sortie de la Première Guerre mondiale. L’Empire ottoman est dépecé par les puissances impérialistes victorieuses, l’actuelle Turquie est alors occupée par les troupes grecques et anglaises. Mustafa Kemal et les jeunes officiers turcs prennent la tête de la lutte nationale et réussissent à repousser les troupes impérialistes. Ils construisent un appareil d’État qui effectue une série de réformes de « modernisation » de la Turquie : utilisation de l’alphabet latin, du droit suisse pour le commerce, français pour le civil, ils fondent des écoles d’ingénieurs basées sur le modèle existant en Allemagne. Ils déploient une véritable politique de sécularisation du pays : la Turquie vit une forme de « révolution par le haut », la bourgeoisie turque cherche à se donner les moyens de sortir du sous-développement et du statut de « semi-colonie », comme le Japon a pu réussir à le faire quelques décennies plus tôt. Ces développements n’échappent pas à l’Internationale communiste et au jeune État soviétique, qui cherchent dans la Turquie kémaliste un allié contre les puissances impérialistes. Il est parfois nécessaire de s’allier « au Diable ou à sa grand-mère », mais l’Internationale communiste de Lénine cherche à construire un parti communiste en Turquie, malgré les tentatives de répression de l’État turc.
Le nouvel État turc de Mustafa Kemal qui sort de la guerre mondiale est un appareil d’État bourgeois, c’est-à-dire garant de l’exploitation – comme aujourd’hui. Le corps des officiers qui en constitue le noyau s’est formé dans un nationalisme exacerbé et meurtrier : il a les mains tâchées de sang de sa participation au génocide arménien pendant la guerre, et cherche ensuite à mettre au pas les différentes minorités qui existent sur l’ensemble du territoire, qu’ils soient kurdes, arméniens, grecs, alévis… Le 1er novembre 1922, quelques semaines à peine après sa victoire militaire – réalisée grâce à la mobilisation des différents peuples de Turquie, comme les Kurdes – Mustafa Kemal proclame que « l’État qui vient d’être fondé est un État turc ». Celui-ci se construit sur une répression violente des minorités dans l’espoir de les assimiler, de les effacer.
Un tel héritage nationaliste pèse évidemment sur les mobilisations actuelles. Face à l’obscurantisme religieux sur lequel s’appuie Erdoğan, nombreux sont les manifestants qui trouvent dans le kémalisme un contrepoids « démocratique », laïc et séculaire qui reste d’ailleurs très acceptable pour la bourgeoisie turque. Mais derrière, le nationalisme kémaliste, même sous sa forme « progressiste », reste un nationalisme – un frein à la prise de conscience des intérêts de classe du prolétariat à la formulation d’une politique pour l’ensemble des exploités. Qui pourrait imaginer que les Kurdes, qui constituent un quart de la population de Turquie, puissent manifester le baume au cœur à côté de jeunes scandant « Nous sommes les soldats d’Atatürk ». Les discours nationalistes turcs participent à éloigner les travailleurs kurdes ou arméniens des manifestations et Erdoğan s’appuie sur cette faiblesse du mouvement pour diviser les travailleurs entre eux. Ainsi, celui-ci a le beau jeu de dénoncer les propos du maire CHP d’Ankara, un ultranationaliste, qui en pleine manifestation contre Erdoğan, dénonçait sur la place Saraçhane un prétendu « deux poids deux mesures » contre les manifestants à Istanbul alors qu’un « parti dans l’est du pays » organise des rassemblements (le Newroz – fête kurde) dans lesquels est agité un « torchon » (drapeaux kurdes et du PKK) et où on offre des barbes-à-papa aux jeunes alors qu’« ici » (à Istanbul ou Ankara) « on matraque les jeunes ».
III) Le piège du processus de paix
Les Kurdes constituent encore aujourd’hui un peuple sans État. Plus de quarante millions de Kurdes vivent en Turquie, Irak, Syrie et Iran, dont près de la moitié en Turquie. Ces différents États renient depuis des décennies les droits nationaux des Kurdes, leur interdisant de pratiquer leur langue en public, de fêter leurs fêtes culturelles, etc. L’histoire du peuple kurde est faite de compromis ponctuels avec les régimes en place, quand ceux-ci ont besoin d’eux, à la trahison des accords et la répression très vite. Dernière trahison en date, l’utilisation du parti frère du PKK, le PYD, par l’impérialisme américain dans sa lutte contre Daesh pendant la guerre civile syrienne. Les États-Unis ont beau apporter un soutien logistique aux Forces démocratiques syriennes (FDS), ils les laissent complètement tomber face à l’offensive turque d’Erdoğan une fois la menace djihadiste fortement diminuée. Aujourd’hui encore, la survie du Rojava, face à un nouveau gouvernement HTC syrien lié à la Turquie, dépend du bon vouloir de Trump, qui évalue la nécessité d’apporter son soutien ou non à l’enclave kurde au nord-est syrien.
Et la politique d’Erdoğan dans le nord syrien a une motivation essentielle : éviter une autonomie des Kurdes de Syrie qui renforcerait les revendications des Kurdes de Turquie. D’où la guerre qu’Erdoğan mène au nord de la Syrie. En même temps qu’en Turquie Erdoğan vient d’obtenir un renoncement à la lutte du fondateur de PKK, Öcalan. Comme on l’a vu, Erdoğan ne manie pas que le bâton, il manie aussi la carotte. Mis en difficulté par le CHP et souhaitant modifier la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat de président, Erdoğan a engagé depuis plusieurs mois des négociations avec le DEM et le PKK, directement depuis la prison d’Öcalan afin d’engager un processus de « paix ». À la clé pour le PKK, la fin de sa persécution et la possibilité d’être un parti « comme les autres », la fin des offensives contre le Rojava syrien. Pour l’instant, seul le PKK semble remplir sa part du marché, alors qu’il engage sa démilitarisation. Mais le processus de « paix » entrave la participation des jeunes et de la classe ouvrière kurde dans la lutte aux côtés de leurs frères et sœurs turcs : ni le PKK ni le DEM ne mettent tout leur poids dans la lutte contre la tentative de coup d’État d’Erdoğan. Pourtant, nul doute que si celui-ci réussit à survivre à la colère populaire, il reprendra ses offensives contre la population kurde.
Heureusement, cet attentisme des organisations nationalistes kurdes n’empêche pas des milliers de jeunes et travailleurs kurdes de manifester en ce moment, malgré le nationalisme ambiant des manifestations et les tentatives de l’extrême droite d’isoler les revendications nationales kurdes. Les politiques nationalistes, aussi bien des organisations turques que kurdes, participent à désorganiser et démoraliser celles et ceux qui auraient pourtant intérêt à se battre ensemble. Les Kurdes peuvent en vouloir à raison à ceux qui n’ont pas bougé le petit doigt quand Erdoğan exerçait déjà sa dictature au Kurdistan, tandis que les manifestants turcs ont sans doute l’impression d’être abandonnés par les partis kurdes qui négocient dans leur dos avec Erdoğan.
IV) Quelles perspectives pour le mouvement ?
Où en est le mouvement aujourd’hui ? Depuis lundi, les manifestations ont repris dans les universités, d’où le mouvement a débuté. Dès l’annonce de l’arrestation d’Ekrem İmamoğlu, les étudiants de l’Université d’Istanbul sont sortis dans la rue, entraînant derrière eux la majorité des campus du pays. La mobilisation étudiante ne se résume pas aux images impressionnantes des jeunes s’affrontant avec les forces de police et réussissant à briser ses barrages. Dans de nombreuses universités, des « forums » (autre nom pour assemblée générale) réunissent des dizaines, des centaines d’étudiants pour organiser le « boycott universitaire » (c’est-à-dire la grève des cours) et déterminer leurs moyens d’action. Nous avons aussi entendu qu’il existerait une « Coordination nationale étudiante », à laquelle des représentants de quinze universités participeraient, mais nous n’avons pas la confirmation exacte de son existence ou de la politique qu’elle porte. C’est bien la détermination des étudiants, qui en ont marre de voir Erdoğan gouverner depuis leur naissance et qui n’apprécient pas que le pouvoir puisse juste « retirer » son diplôme à qui il veut, qui a entraîné le CHP à sortir dans la rue pour garder la main sur la contestation. Mais si, à juste titre, les étudiants ont plus que des doutes sur le CHP et les autres partis politiques institutionnels, il n’est pas simple de trouver le chemin vers le dégagement du régime.
D’autant plus que le régime manie la répression avec violence. Depuis le début des manifestations, plus de 300 étudiants ont été arrêtés et placés en détention, dont de nombreux animateurs de la grève universitaire et militants d’extrême gauche. En tout, plus de 3 000 personnes ont été arrêtées, dont de nombreuses personnes chez elles en rentrant de manifestation ou en se levant le matin. Le gouvernement est allé jusqu’à allonger les fêtes de fin de Ramadan de trois à neuf jours pour forcer les jeunes à retourner chez eux afin de casser la dynamique collective, mais ça n’a pas totalement fonctionné. Quant au CHP, il appelle désormais à une manifestation nocturne hebdomadaire le mercredi à Istanbul, et une manifestation par semaine dans une autre ville du pays. Pas question pour lui d’appeler à la grève ou à des manifestations coordonnées dans tout le pays, alors même que la contestation à Erdoğan touche non seulement les grandes villes mais aussi les bastions régionaux de l’AKP – où la répression est d’ailleurs plus importante, signe de la peur du régime. Pas question non plus de mettre en avant les questions économiques, contre l’inflation ou le chômage, le CHP restreint la lutte aux questions démocratiques. Pourtant, l’idée de s’adresser à la classe ouvrière fait son bout de chemin dans les esprits, comme à l’Université Galatasaray où, d’après des camarades socialistes avec qui nous sommes en lien, les étudiants réfléchissent à intervenir dans les quartiers ouvriers.
En effet, la classe ouvrière de Turquie est nombreuse et puissante. Elle est concentrée dans de grands complexes industriels de la métallurgie, de l’automobile, dans l’industrie de l’exportation. Citons au moins come exemple les usines du groupe allemand Bosh, ou l’usine Renault de Burça, deux gros secteurs industriels qui avaient fait un important mouvement de grève en 2013. Cependant, si la classe ouvrière est nombreuse numériquement, le mouvement ouvrier, lui, a bien des handicaps : des syndicats maison, une répression des syndicalistes combatifs. Les traditions socialistes ou d’organisation démocratique sont mises à mal par la présence de puissants syndicats corporatifs qui arrivent encore aujourd’hui à encadrer la classe ouvrière, même si le taux de syndicalisation diminue depuis les années 2000. Si la Disk (Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie) peut faire office de « CGT » là-bas – et on connait les limites de la CGT ici – les principales organisations syndicales, comme le Türk-Iş (Confédération des syndicats turcs) a une longue histoire de coopération avec l’appareil d’État, qu’on peut retracer à sa fondation en 1951, appuyée par le plan Marshall pour empêcher le développement des idées socialistes ou communistes au sein de la classe ouvrière. Quant aux organisations socialistes ou révolutionnaires, elles assument le coup de la répression depuis 2013 et surtout 2016. Si certaines organisations d’extrême gauche arrivent à influencer et diriger certaines sections syndicales du Disk (chez les profs mais aussi dans la métallurgie), leur influence a diminué depuis la révolte de Gezi. Mais seules ces organisations, marxistes, trotskistes, ou de tradition maoïste (souvent dites « marxistes-léninistes ») mettent en avant la nécessité d’adresser les problèmes de la classe ouvrière, de refuser le nationalisme et d’appeler à la grève – ce qui vaut à certains dirigeants syndicaux d’extrême gauche d’être arrêtés. Certains camarades racontent que dans les universités, il est difficile de sortir un drapeau rouge, car certains étudiants nationalistes leur arrachent des mains.
Malgré le slogan « Résistance générale, grève générale » populaire dans les universités, les pas à effectuer pour arriver effectivement à une grève générale restent flous. C’est principalement la question du « boycott » qui apparaît comme une solution face au régime : un jour par semaine, on arrête d’acheter les produits liés à l’AKP et aux islamistes – qui contre-attaquent en mobilisant leur base pour acheter en masse leurs produits. Face à la répression, le boycott apparaît comme une arme qui permet de contester le régime, tout en gardant sa sécurité individuelle. Malheureusement, le boycott, s’il peut déranger une partie de la bourgeoisie attachée à Erdoğan et arranger ceux qui lui sont opposés, ne remet pas en cause le pouvoir d’Erdoğan sur l’appareil d’État : il a les moyens d’attendre que la mobilisation et le boycott faiblissent. Seule une grève générale pourrait mettre une pression suffisante sur l’ensemble de la bourgeoisie pour dégager Erdoğan, mais aussi permettre aux manifestants et grévistes de poser les bases d’une autre structuration du mouvement, sur les lieux de travail et universités, qui pourraient à terme constituer les germes d’une autre société.
V. C’est une intervention de la classe qui pourrait vraiment changer les choses
Derrière Erdoğan et son régime, c’est tout un système capitaliste dont il est question. Celles et ceux qui manifestent aujourd’hui combattent évidemment la mainmise d’un homme et d’un parti au pouvoir depuis deux décennies, mais c’est tout le système qui s’identifie à ce régime qui maintient la population dans la pauvreté, la violence des conditions de travail. Les inégalités continuent de se creuser alors que le nombre de milliardaires, lui, continue de grimper. Le CHP n’est prêt à se débarrasser d’Erdoğan que pour préserver le régime d’exploitation capitaliste, et il n’est pas sûr du tout qu’il sera plus démocratique une fois au pouvoir, sans la pression des masses. Ce qui se joue aujourd’hui entre l’AKP et le CHP, c’est une lutte de pouvoir au sein de l’appareil d’État, dont chaque protagoniste souhaite éviter de faire « péter » la Turquie – ils ont peur d’un scénario à la syrienne ou à la libyenne, où les classes dominantes se déchirent et les impérialistes interviennent, ce qui pourrait redessiner les cartes de la Turquie. Cette peur de l’inconnu, d’un risque de prise de pouvoir de bandes encore plus nationalistes et autoritaires ou d’un coup d’État de l’armée (qui ne s’est toujours pas exprimée, à notre connaissance depuis le début de la crise politique) pèse aussi dans les organisations d’extrême gauche et sans doute une partie de la population.
La lutte contre la dictature est une lutte contre l’ensemble de la bourgeoisie turque et seule la classe ouvrière turque est capable de la mener à bien, à condition de défendre ses intérêts et ceux de l’ensemble des exploités (par exemple, les Kurdes). Erdoğan ne s’y trompe pas quand il harcèle systématiquement les organisations socialistes en Turquie, la solution est là.
Un mouvement, voire une victoire de la classe ouvrière turque et kurde, entraînerait des conséquences bien au-delà des frontières de la Turquie : en Syrie, en Iran mais aussi en direction des Balkans où la Serbie et la Grèce connaissent déjà de forts mouvements sociaux. Mais nous ne pouvons pas oublier le poids des travailleurs turcs ou kurdes dans la diaspora en Europe, où ceux-ci travaillent côte-à-côte avec les travailleurs européens.
La mobilisation actuelle en Turquie se trouve dans un moment charnière pour les prochains jours et semaines. Les regards se tournent déjà vers les manifestations du 1er mai qui s’annoncent massives, mais il reste encore plusieurs semaines d’ici-là et beaucoup va se jouer. La répression va-t-elle réussir à briser la détermination des étudiants ? Ceux-ci vont-ils réussir à se tourner vers les travailleurs et réussir à les entraîner par-dessus la tête de leurs organisations syndicales ? Nous n’avons évidemment pas de réponses à ces questions, mais nous espérons participer ici à la construction non seulement d’un mouvement de solidarité internationaliste qui puisse apporter de la force et de l’espoir en Turquie mais aussi d’un parti communiste révolutionnaire international, qui soit à mène d’apporter des perspectives socialistes à la mobilisation là-bas. Si vous vous retrouvez dans ces perspectives, nous vous invitons à prendre contact avec nous pour préparer les suites.